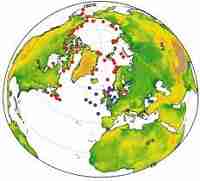Les années 1970 : l'ouverture de nouvelles pistes
Le nouveau contexte et le poids des représentations
La disparition de la géographie culturelle qui semblait ainsi programmée au début des années 1970 n’a pas eu lieu. L’uniformisation des techniques et de la vie matérielle n’a jamais été aussi marquée qu’aujourd’hui : on est entré dans l’ère du voyage immobile, celle qui conduit les touristes d’une chambre d’hôtel Hilton à une autre chambre Hilton bâtie sur le même plan, avec les mêmes équipements et maintenue, grâce à la climatisation, à la même température quelles que soient les conditions météorologiques extérieures. Les jeunes gens portent partout les mêmes jeans — mais un nombre croissant milite dans des mouvements écologistes en Occident, fondamentalistes au Moyen-Orient. Les nationalismes que l’on croyait laminés par deux générations de marxisme-léninisme sont plus virulents que jamais dans les pays de l’Est. En Occident, les religions instituées traversent une crise. L’inquiétude religieuse perceptible chez beaucoup se traduit par la multiplication des sectes et la volonté d’expérimenter des formes nouvelles de culte et de se conformer à de nouveaux rituels.
L’habitude s’est prise, il y a une dizaine d’années, de dire que nous vivions dans un monde postmoderne (voir chap. 14). Cela se traduit par un goût affirmé pour le kitsch comme décor de la vie de tous les jours, et par la liberté avec laquelle on joue désormais avec tous les styles. Le monde dans lequel nous vivons est celui des consommations culturelles de masse (Claval, 1979).
Le contexte oblige donc les géographes à ne pas négliger les dimensions culturelles des faits qu’ils observent. Il oriente leur curiosité dans une nouvelle direction : les techniques sont devenues trop uniformes pour retenir l’attention ; ce sont les représentations, négligées jusqu’alors, qui méritent d’être étudiées.
Des réalités économiques, sociales et politiques à la culture
La recherche a beaucoup porté, au cours des quarante dernières années, sur les dimensions économiques, sociales et politiques de la géographie. Dans ces domaines, l’ambition était de découvrir des régularités. Elle n’a pas été déçue : les géographes ont appris la pertinence des modèles de gravitation, mis en évidence la logique qui explique la structuration des réseaux de transport, des systèmes de communication et des lieux centraux, et compris l’organisation annulaire de l’espace autour des foyers où s’organisent les rencontres et les échanges. Mais les régularités qui naissent ainsi du poids de la distance ne doivent pas masquer la diversité des objectifs poursuivis par les agents économiques : la dimension cultu¬relle se profile à l’arrière-plan.
La fréquentation des ethnologues et des sociologues a appris à transformer l’analyse des genres de vie. L’instrument imaginé par Vidal de La Blache était trop synthétique et trop global pour saisir la structure diversifiée des sociétés contemporaines. Au lieu de considérer que l’emploi du temps et les déplacements des individus constituent des unités indissociables, pourquoi ne pas les diviser en segments plus petits ? C’est ce que propose l’analyse des rôles (Claval, 1973 ; 1974 ; 1987) : elle souligne la diversité des relations auxquelles les hommes participent et des informations qu’ils en retirent ; la culture n’apparaît plus comme une réalité monolithique ; chacun en reçoit une copie différente, qu’il modifie au gré de son existence.
La time geography que développe Torsten Hâgerstrand (1975) reconstitue les trajectoires individuelles dans l’espace et repère les lieux et les moments où les différents rôles sont assumés. Elle modernise ainsi les techniques d’analyse des emplois du temps imaginées par Jean Brunhes. La vie de chacun apparaît comme une succession de partitions tour à tour assumées. Le genre de vie correspond au type de séquences standardisées que l’on peut mettre en évidence dans les sociétés traditionnelles. Dans le monde urbain et industriel, il faut mener des études plus fines : chacun combine les rôles élémentaires de manière différente.
Les rôles sont complémentaires : ceux du père, de la mère et des enfants défi¬nissent la famille ; ceux du patron, de l’ingénieur, du contremaître et des ouvriers, l’entreprise. Les rapports sociaux ainsi structurés sont souvent institutionnalisés et constituent l’armature sociale propre à chaque groupe ; une certaine organisation de l’espace lui est liée (Claval, 1973 ; 1978).
Les travaux de géographie économique, sociale et politique débouchent sur deux types de constatations :
La vie sociale et économique reflète la diversité de comportements culturels. Un climat de confiance est nécessaire au bon fonctionnement de certaines institutions : une organisation est d’autant plus performante que tous ses membres sont persuadés de l’importance de la mission qu’elle a à remplir, et acceptent d’y travailler avec enthousiasme.
Les explications proposées par la géographie économique, sociale ou politique ne sont jamais universelles parce que l’action humaine n’est pas totalement prévisible et échappe à la standardisation.
Ces résultats vont à l’encontre des théories longtemps dominantes, le marxisme en particulier, pour lesquelles tout pouvait se ramener aux rapports de production, le reste ne constituant qu’un folklore secondaire.
La nouvelle géographie à la manière des années 1960 et 1970 débouche donc sur des questions de nature culturelle.
Le sens des lieux et la littérature
Le renouveau de la géographie culturelle s’esquisse dès le début des années 1970. Il se manifeste alors à peu près partout de la même manière : les lieux n’ont pas seule¬ment une forme et une couleur, une rationalité fonctionnelle et économique. Ils sont chargés de sens par ceux qui y habitent ou qui les fréquentent. Les recherches sur la perception de l’espace et de l’environnement menées par les psychologues sont mises à profit. Le roman devient un document : l’intuition subtile des écrivains fait découvrir le monde à travers les yeux de leurs personnages.
Les travaux sur le sens des lieux et sur ce que la littérature apprend à ce sujet sont nombreux dans le monde anglo-saxon dès le début des années 1970. Armand Frémont incarne en France une sensibilité analogue : il s’interroge sur La région, espace vécu (1976) et montre que les diverses composantes de la population normande ne vivent pas cette province de la même façon (1976 ; 1981).
La montée des préoccupations humanistes
La géographie humaine est née comme une branche des sciences naturelles, mais une réaction s’esquisse dès le début des années 1950. En Grande-Bretagne, William Kirk se soucie du contexte qui pèse sur les comportements (1952). En France, Eric Dardel publie la même année L’Homme et la terre Nature de la réalité géographique (1952). Sa foi protestante et l’influence de Heidegger transparaissent dans son ouvrage. Les hommes s’interrogent sur les raisons de leur présence sur cette terre ; ils éprouvent le besoin de donner un sens à leur existence et au monde dans lequel ils vivent. C’est de cela que les géographes doivent partir dans leur analyse.
La leçon d’Éric Dardel passe inaperçue en France. Elle est redécouverte vingt ans plus tard en Amérique du Nord, au Canada en particulier, où de nouvelles attitudes apparaissent. Yi-Fu Tuan s’intéresse à l’attachement que les gens manifestent pour leur pays et à l’expérience qu’en ont les milieux populaires. Il parle de géosophie. Les étudiants qu’il forme à Toronto à la fin des années 1960, Edward Relph ou Léonard Guelke en particulier, sont très imginatifs. Un certain nombre d’auteurs marqués par leur foi chrétienne ou juive se retrouvent sur des positions voisines : Anne Buttimer ou Marwyn Samuels par exemple. Ils tirent parti de leurs lectures philosophiques, invoquent Heidegger et déclarent pratiquer une démarche phéno¬ménologique. Le terme est trop savant pour être adopté par la plupart des géogra¬phes. Lorsque Yi-Fu Tuan propose, en 1976, de parler simplement d’approche humaniste, la partie est gagnée. Le nouveau courant apparaît comme une des composantes indispensables de toute démarche géographique. En insistant sur le sens des lieux, sur l’importance du vécu, sur le poids des croyances religieuses, il rend indispensable une étude approfondie des représentations culturelles.
La culture comme discours
La manière dont les géographes appréhendaient la culture ne différait guère, au début du xxe siècle, de celle adoptée par les ethnographes et les ethnologues. Les uns et les autres s’intéressaient prioritairement aux outillages, aux artefacts, aux champs, à l’habitat. Les ethnologues y ajoutaient, c’est vrai, un inventaire des croyances, des mythes et des rituels ; ils s’interrogeaient sur la signification des tabous ou sur le rôle de la magie. Dans leurs travaux, les aspects matériels des cultures pesaient cependant plus que les représentations.
L’équilibre entre les deux aspects de l’analyse des cultures se modifie progressivement. La part faite au discours va croissante : elle est dominante dans les ouvrages de Lévi-Strauss où celui-ci décortique les mythes (Lévi-Strauss, 1962). Les géographes ignorent un temps cette évolution.
Jusqu’aux années 1970, l’ethnologie et l’ethnographie continuent cependant à être conçues sur le modèle habituel des sciences de l’homme et de la société. Leurs certitudes s’effondrent progressivement. Le tableau rationnel que proposent les ethnologues n’est pas intrinsèquement supérieur à celui qui se dégage des pratiques ou des discours des ceux qu’ils observent, remarque Clifford Geertz. Le rôle de l’ethnologue n’est-il pas alors de nous faire partager les points de vue des populations auxquelles il s’intéresse ? La multiplicité des perspectives qu’elles adoptent renseigne sur la complexité de la société étudiée et sur les intérêts divers qui la traversent.
Clifford Geertz (1993) imagine un nouveau type d’enquête, qui repose sur des descriptions en profondeur – il parle de thick description. L’ethnologue donne désormais la parole aux gens observés et note leurs discours et leurs réactions dans diverses circonstances.
Les préoccupations de certains philosophes contemporains vont dans le même sens : ils attachent beaucoup de poids au rôle des discours dans la vie collective, et en font leur sujet préféré d’étude. On assiste ainsi, de Roland Barthes et de Michel Foucault à Jacques Derrida, au développement d’une nouvelle épistémo- logie. En mettant l’accent sur la langue et sur la manière dont les gens parlent du monde, ou parlent le monde, elle offre à ceux qui critiquent le néo-positivisme la possibilité de faire un travail rigoureux, mais sans imposer au monde social des cadres qui le trahissent.
Vidéo : Les années 1970 : l’ouverture de nouvelles pistes
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : Les années 1970 : l’ouverture de nouvelles pistes