L'effet de serre additionnel : catastrophisme
Le catastrophisme
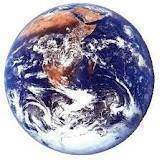
Cette avalanche de prévisions est formulée dans une langue de bois qui rappelle furieusement celle des documents de la Commission européenne ou de l’OCDE. On évite autant qu’il est possible le mot « politique », qui évoque les fureurs partisanes, les décisions prises dans le sens du vent et plus généralement les décennies d’affrontements politiques qui ont précédé la chute du mur de Berlin. Et depuis que s’est mondialisé le consensus « libéral », on utilise plutôt le mot « gouvernance », comme s’il s’agissait d’une science débarrassée de toute contamination idéologique. On évite aussi « capitalisme »’, qui rappelle tant de mauvais souvenirs (voir plus haut), au profit de l’expression plus présentable d’« économie de marché » ou, par un étonnant abus de langage, d’économie « libérale ».
Il n’est donc pas étonnant que les documents du GIEC agacent. Ils ont même suscité de véritables brûlots, auxquels ont répondu d’autres brûlots. Pour l’exprimer de manière à peine caricaturale, les scientifiques membres du GIEC ou qui le défendent se seraient vendus aux intérêts des tenants de la mondialisation impérialiste nord-
américaine. De leur côté, les scientifiques du GIEC seraient attaqués par des non-scientifiques, ignorants et confus dans l’expression.
Exemple pris dans un ouvrage récent du journaliste Jean-Paul Croizé : « Ils ne font encore qu’écrire un mauvais film de science-fiction, ces maîtres du changement climatique constitués par une poignée de scientifiques enfermés dans une tour d’ivoire, celle de l’ONU, à New York (…) ces mauvais prophètes organisent depuis plus de quinze ans un vaste complot à l’échelle mondiale pour tenter de faire cesser l’émission de carbone dans l’atmosphère. »’ Et, naturellement, l’un de ces « mauvais prophètes » (ou presque), le bouillant Jean-Marc Jancovici, de rétorquer à propos de ce livre : « “De l’art d’être confus” pourrait être le sous-titre de cet ouvrage, dont il est difficile de tirer une conclusion claire, même si l’on sent bien que l’auteur s’inscrit plus ou moins (généralement plutôt plus que moins) dans la ligne du dénonciateur de complot, exposant que toute cette affaire de changement climatique n’est que poudre aux yeux. » Et, plus loin, d’évoquer la stigmatisation par Jean- Paul Croizé des « comploteurs onusiens éhontés », etc.
Sur un autre registre, Yves Lenoir, chercheur à l’École des mines de Paris, traite le GIEC de « machinerie climat-ocratique »qui « (…) génère sa propre légitimité, invente un discours qui lui donne raison (…) Le tout sans aucun contrôle démocratique ». Et de poursuivre : « D’un point de vue opérationnel, on s’aperçoit que le GIEC, comme la plupart des institutions onusiennes, bâtit des projets scientifiques à long terme destinés d’abord à lever des fonds. Une fois que la machine est lancée, elle tourne toute seule et les financements arrivent de façon quasi automatique. Il faut bien avoir ce fonctionnement à l’esprit quand on se penche sur la question climatique et le discours catastrophiste qui l’accompagne. »*
On pourrait multiplier les exemples, en rester là et renvoyer dos à dos partisans et adversaires du GIEC. Il convient pourtant d’éviter ce parti pris car, au-delà de leur forme plus que discutable, certains arguments utilisés par les critiques du GIEC ne manquent pas de pertinence. Je ne retiendrai ici que les principaux. Par exemple, celui – déjà relevé dans ce livre – qui est avancé par Jean-Paul Croizé à propos de ce que retiennent les médias, donc le public, des travaux du GIEC : « Quelles que soient la teneur réelle et les multiples incertitudes exprimées dans chacun des documents établis par le GIEC pour publier ses rapports d’évaluation (…) les grandes réunions internationales sur le climat (…) sont toutes appuyées sur des synthèses de ces rapports. C’est-à-dire sur des documents simplifiés qui ne tenaient pas compte des réserves émises par les scientifiques lors de chacune – ou presque – des études menées. »
Par ailleurs, poursuit le journaliste : « (…) est-il absolument certain, c’est-à-dire démontrable scientifiquement, que l’évolution de la température globale de l’atmosphère a laquelle nous assistons actuellement n’est pas d’origine naturelle, au moins dans sa plus grande partie ? »II ne semble pas que les scientifiques, y compris les experts du GIEC, en soient actuellement capables – ce qui ne signifie pas que leurs quasi-certitudes soient infondées, mais c’est pourtant une interrogation soulevée par beaucoup de géographes-climatologues.
Corrélativement, pourquoi cette insistance du GIEC sur l’accroissement du taux de C02 dans l’atmosphère alors que la question des rejets de méthane (CH, et plus généralement des autres gaz à effet de serre, est reléguée au second plan ? L’argument qui consisterait à répondre que ces gaz n’existent qu’à l’état de traces dans l’atmosphère serait irrecevable pour deux raisons. La première est que c’est également le cas du gaz carbonique (0,037 %) et, dans un autre domaine, de l’ozone : ce dernier gaz, dont le taux de concentration dans l’atmosphère est infinitésimal, joue cependant un rôle majeur dans la protection des êtres vivants contre les rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil. La seconde raison est que les gaz à effet de serre autres que le C02 jouent un rôle tout aussi important que ce dernier : ils contribueraient à plus de 60 % de l’effet de serre global. Il est vrai que dans cet éventail, la vapeur d’eau se taille la part du lion (55 % environ de l’effet de serre total), et que nous n’y pouvons rien. En outre, les gaz à effet de serre n’absorbent pas les rayons infrarouges réémis par la Terre dans les mêmes longueurs d’onde. Ils ont donc tous une grande importance. D’ailleurs, l’augmentation du taux de concentration de tel ou tel gaz à effet de serre dans l’atmosphère a un impact d’autant plus important que la proportion du rayonnement qu’il absorbe déjà est faible.
Les adversaires du GIEC avancent beaucoup d’autres arguments ingénieux auxquels les experts climatologues répondent tout aussi ingénieusement, ce qui laisse le public assez perplexe lorsqu’il se refuse à suivre passivement le mouvement dominant. L’objet de ce livre n’est pas de trancher dans le débat, toujours ouvert. Mais, au risque de choquer les adversaires du giec, et malgré les réticences que je viens de formuler, il semble bien que les conclusions scientifiques des experts soient à prendre très au sérieux. Certes, les modèles sont très imparfaits; certes, le réchauffement actuel paraît infime en regard des fluctuations climatiques du passé ; certes, les données dont nous disposons sont insuffisantes ; certes l’activité solaire a peut-être été sous-estimée par les climatologues. Il reste cependant que la marge d’incertitude quant à un effet de serre additionnel consécutif aux activités humaines est devenue assez infime pour justifier l’application du principe de précaution, sans plus attendre que les experts soient formels et unanimes (ils ne le sont jamais). C’est peut-être mutile, mais nous sommes au moins assurés d’une chose, c’est que si les conclusions du rapport de 2001 sont un jour absolument avérées, nous aurons beaucoup à regretter nos atermoiements.
Plus généralement, l’idée très répandue dans le public selon laquelle les prises de décision politiques devraient être subordonnées à des certitudes scientifiques est ruineuse. Pourquoi ? Parce que la science, au cours même de son élaboration est marquée par une multitude de facteurs qui lui sont extérieurs, du moins en apparence : la politique, l’idéologie de la classe dominante, les idées préconçues, le trajet biographique des scientifiques, la politique de la recherche, l’état des disciplines voisines, le matériel expérimental, etc. Croire que la science est pure et neutre est une illusion. Le temps n’est pas si loin où des anthropologues au-dessus de tout soupçon passaient le plus clair de leurs recherches à mesurer, au nom de la science, des crânes et des volumes crâniens pour découvrir des inégalités entre les races, les sexes et les classes sociales.
Exemple pris dans un ouvrage récent du journaliste Jean-Paul Croizé : « Ils ne font encore qu’écrire un mauvais film de science-fiction, ces maîtres du changement climatique constitués par une poignée de scientifiques enfermés dans une tour d’ivoire, celle de l’ONU, à New York (…) ces mauvais prophètes organisent depuis plus de quinze ans un vaste complot à l’échelle mondiale pour tenter de faire cesser l’émission de carbone dans l’atmosphère. »’ Et, naturellement, l’un de ces « mauvais prophètes » (ou presque), le bouillant Jean-Marc Jancovici, de rétorquer à propos de ce livre : « “De l’art d’être confus” pourrait être le sous-titre de cet ouvrage, dont il est difficile de tirer une conclusion claire, même si l’on sent bien que l’auteur s’inscrit plus ou moins (généralement plutôt plus que moins) dans la ligne du dénonciateur de complot, exposant que toute cette affaire de changement climatique n’est que poudre aux yeux. » Et, plus loin, d’évoquer la stigmatisation par Jean- Paul Croizé des « comploteurs onusiens éhontés », etc.
Sur un autre registre, Yves Lenoir, chercheur à l’École des mines de Paris, traite le GIEC de « machinerie climat-ocratique »qui « (…) génère sa propre légitimité, invente un discours qui lui donne raison (…) Le tout sans aucun contrôle démocratique ». Et de poursuivre : « D’un point de vue opérationnel, on s’aperçoit que le GIEC, comme la plupart des institutions onusiennes, bâtit des projets scientifiques à long terme destinés d’abord à lever des fonds. Une fois que la machine est lancée, elle tourne toute seule et les financements arrivent de façon quasi automatique. Il faut bien avoir ce fonctionnement à l’esprit quand on se penche sur la question climatique et le discours catastrophiste qui l’accompagne. »*
On pourrait multiplier les exemples, en rester là et renvoyer dos à dos partisans et adversaires du GIEC. Il convient pourtant d’éviter ce parti pris car, au-delà de leur forme plus que discutable, certains arguments utilisés par les critiques du GIEC ne manquent pas de pertinence. Je ne retiendrai ici que les principaux. Par exemple, celui – déjà relevé dans ce livre – qui est avancé par Jean-Paul Croizé à propos de ce que retiennent les médias, donc le public, des travaux du GIEC : « Quelles que soient la teneur réelle et les multiples incertitudes exprimées dans chacun des documents établis par le GIEC pour publier ses rapports d’évaluation (…) les grandes réunions internationales sur le climat (…) sont toutes appuyées sur des synthèses de ces rapports. C’est-à-dire sur des documents simplifiés qui ne tenaient pas compte des réserves émises par les scientifiques lors de chacune – ou presque – des études menées. »
Par ailleurs, poursuit le journaliste : « (…) est-il absolument certain, c’est-à-dire démontrable scientifiquement, que l’évolution de la température globale de l’atmosphère a laquelle nous assistons actuellement n’est pas d’origine naturelle, au moins dans sa plus grande partie ? »II ne semble pas que les scientifiques, y compris les experts du GIEC, en soient actuellement capables – ce qui ne signifie pas que leurs quasi-certitudes soient infondées, mais c’est pourtant une interrogation soulevée par beaucoup de géographes-climatologues.
Corrélativement, pourquoi cette insistance du GIEC sur l’accroissement du taux de C02 dans l’atmosphère alors que la question des rejets de méthane (CH, et plus généralement des autres gaz à effet de serre, est reléguée au second plan ? L’argument qui consisterait à répondre que ces gaz n’existent qu’à l’état de traces dans l’atmosphère serait irrecevable pour deux raisons. La première est que c’est également le cas du gaz carbonique (0,037 %) et, dans un autre domaine, de l’ozone : ce dernier gaz, dont le taux de concentration dans l’atmosphère est infinitésimal, joue cependant un rôle majeur dans la protection des êtres vivants contre les rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil. La seconde raison est que les gaz à effet de serre autres que le C02 jouent un rôle tout aussi important que ce dernier : ils contribueraient à plus de 60 % de l’effet de serre global. Il est vrai que dans cet éventail, la vapeur d’eau se taille la part du lion (55 % environ de l’effet de serre total), et que nous n’y pouvons rien. En outre, les gaz à effet de serre n’absorbent pas les rayons infrarouges réémis par la Terre dans les mêmes longueurs d’onde. Ils ont donc tous une grande importance. D’ailleurs, l’augmentation du taux de concentration de tel ou tel gaz à effet de serre dans l’atmosphère a un impact d’autant plus important que la proportion du rayonnement qu’il absorbe déjà est faible.
Les adversaires du GIEC avancent beaucoup d’autres arguments ingénieux auxquels les experts climatologues répondent tout aussi ingénieusement, ce qui laisse le public assez perplexe lorsqu’il se refuse à suivre passivement le mouvement dominant. L’objet de ce livre n’est pas de trancher dans le débat, toujours ouvert. Mais, au risque de choquer les adversaires du giec, et malgré les réticences que je viens de formuler, il semble bien que les conclusions scientifiques des experts soient à prendre très au sérieux. Certes, les modèles sont très imparfaits; certes, le réchauffement actuel paraît infime en regard des fluctuations climatiques du passé ; certes, les données dont nous disposons sont insuffisantes ; certes l’activité solaire a peut-être été sous-estimée par les climatologues. Il reste cependant que la marge d’incertitude quant à un effet de serre additionnel consécutif aux activités humaines est devenue assez infime pour justifier l’application du principe de précaution, sans plus attendre que les experts soient formels et unanimes (ils ne le sont jamais). C’est peut-être mutile, mais nous sommes au moins assurés d’une chose, c’est que si les conclusions du rapport de 2001 sont un jour absolument avérées, nous aurons beaucoup à regretter nos atermoiements.
Plus généralement, l’idée très répandue dans le public selon laquelle les prises de décision politiques devraient être subordonnées à des certitudes scientifiques est ruineuse. Pourquoi ? Parce que la science, au cours même de son élaboration est marquée par une multitude de facteurs qui lui sont extérieurs, du moins en apparence : la politique, l’idéologie de la classe dominante, les idées préconçues, le trajet biographique des scientifiques, la politique de la recherche, l’état des disciplines voisines, le matériel expérimental, etc. Croire que la science est pure et neutre est une illusion. Le temps n’est pas si loin où des anthropologues au-dessus de tout soupçon passaient le plus clair de leurs recherches à mesurer, au nom de la science, des crânes et des volumes crâniens pour découvrir des inégalités entre les races, les sexes et les classes sociales.
Nous n’en sommes évidemment pas là avec les experts du GIEC. Néanmoins, beaucoup de questions se posent lorsqu’on se penche sur la dimension institutionnelle de la question. En effet, le GIEC (ipcc) est le résultat d’un montage institutionnel qui n’est pas neutre, et c’est le moins que l’on puisse en dire.
Rappelons que l’iPCC a été fondé à l’initiative du Groupe des 7 (G7), l’institution non formelle qui, depuis le sommet de Rambouillet (France) en 1975, réunit périodiquement les chefs d’État des sept pays les plus riches du monde : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, République fédérale d’Allemagne et Italie. Le G7 se présente parfois comme G7-G8 en raison de l’entrée dans le groupe de la présidence de la Commission européenne. Il faudrait d’ailleurs dire « G9 » en raison de l’entrée récente de la Fédération de Russie. L’objectif déclaré du G7 est d’éviter une crise économique mondiale majeure, en corrélant autant que faire se peut les croissances économiques ainsi que les flux commerciaux et financiers des pays membres, en cherchant à éviter le désordre dans les marchés financiers, et en tentant d’adopter des stratégies économiques harmonisées autant qu’il est possible vis-à-vis des autres pays du monde. C’est dire que les initiatives du G7 sont loin d’être fantaisistes puisqu’elles ont à voir avec l’ordre et la sécurité du monde. Et que cela plaise ou non aux experts climatologues, le GIEC est une pièce du dispositif politique de ce groupe. Mieux, la « Task Force » du GIEC sur les rejets nationaux de gaz à effet de serre a été installée en étroit rapport avec I’ocde, pour qui désormais les jeux sont faits.
Laissons cette organisation puissante et discrète se présenter elle-même : « L’OCDE est un groupe de pays qui partagent les mêmes idées. Pour en devenir membre, un pays doit essentiellement satisfaire à une exigence : être attaché aux principes de l’économie de marché et de la démocratie pluraliste. L’OCDE est “riche” en ce sens que ses membres produisent les deux tiers des biens et services du monde, mais il ne s’agit pas d’un club privé (…) L’OCDE a succédé à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), qui avait été créée pour administrer l’aide des États-Unis et du Canada dans le cadre du plan Marshall destiné à accompagner la reconstruction de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. »* L’OCDE rassemble 30 pays membres et entretient des relations de coopération avec 70 autres. Il s’agit, comme c’est le cas du G7, de « (…) coordonner des politiques intérieures et internationales qui, dans le contexte actuel de mondialisation des économies, doivent former un ensemble de plus en plus homogène ». Les discussions entre ces pays peuvent déboucher sur des décisions juridiquement contraignantes.
Lors d’une réunion des ministres de PEmploi de l’OCDE, dont il est secrétaire général, Donald J. Johnston, a prononcé une allocution dans laquelle il déplorait à juste titre le fait qu’aujourd’hui : « (…) malgré le réchauffement de la planète et la croissance de la demande énergétique, particulièrement dans le monde en développement, de nombreux pays ont renoncé au nucléaire. »La situation est donc prise très au sérieux par l’OCDE. Pourtant, sur la question du réchauffement, cette institution considère qu’il
Rappelons que l’iPCC a été fondé à l’initiative du Groupe des 7 (G7), l’institution non formelle qui, depuis le sommet de Rambouillet (France) en 1975, réunit périodiquement les chefs d’État des sept pays les plus riches du monde : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, République fédérale d’Allemagne et Italie. Le G7 se présente parfois comme G7-G8 en raison de l’entrée dans le groupe de la présidence de la Commission européenne. Il faudrait d’ailleurs dire « G9 » en raison de l’entrée récente de la Fédération de Russie. L’objectif déclaré du G7 est d’éviter une crise économique mondiale majeure, en corrélant autant que faire se peut les croissances économiques ainsi que les flux commerciaux et financiers des pays membres, en cherchant à éviter le désordre dans les marchés financiers, et en tentant d’adopter des stratégies économiques harmonisées autant qu’il est possible vis-à-vis des autres pays du monde. C’est dire que les initiatives du G7 sont loin d’être fantaisistes puisqu’elles ont à voir avec l’ordre et la sécurité du monde. Et que cela plaise ou non aux experts climatologues, le GIEC est une pièce du dispositif politique de ce groupe. Mieux, la « Task Force » du GIEC sur les rejets nationaux de gaz à effet de serre a été installée en étroit rapport avec I’ocde, pour qui désormais les jeux sont faits.
Laissons cette organisation puissante et discrète se présenter elle-même : « L’OCDE est un groupe de pays qui partagent les mêmes idées. Pour en devenir membre, un pays doit essentiellement satisfaire à une exigence : être attaché aux principes de l’économie de marché et de la démocratie pluraliste. L’OCDE est “riche” en ce sens que ses membres produisent les deux tiers des biens et services du monde, mais il ne s’agit pas d’un club privé (…) L’OCDE a succédé à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), qui avait été créée pour administrer l’aide des États-Unis et du Canada dans le cadre du plan Marshall destiné à accompagner la reconstruction de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. »* L’OCDE rassemble 30 pays membres et entretient des relations de coopération avec 70 autres. Il s’agit, comme c’est le cas du G7, de « (…) coordonner des politiques intérieures et internationales qui, dans le contexte actuel de mondialisation des économies, doivent former un ensemble de plus en plus homogène ». Les discussions entre ces pays peuvent déboucher sur des décisions juridiquement contraignantes.
Lors d’une réunion des ministres de PEmploi de l’OCDE, dont il est secrétaire général, Donald J. Johnston, a prononcé une allocution dans laquelle il déplorait à juste titre le fait qu’aujourd’hui : « (…) malgré le réchauffement de la planète et la croissance de la demande énergétique, particulièrement dans le monde en développement, de nombreux pays ont renoncé au nucléaire. »La situation est donc prise très au sérieux par l’OCDE. Pourtant, sur la question du réchauffement, cette institution considère qu’il
est « (…) déjà trop tard pour contrer certaines modifications du climat causées par les activités humaines. Autrement dit, les politiques visant à réduire les émissions de GES devront s’accompagner d’autres mesures pour nous aider à nous adapter aux effets du changement climatique, comme la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes et la montée du niveau des mers »’.
Ainsi, l’OCDE finance une Task Force dont l’objectif est d’évaluer, pays par pays, les émissions de GES, en vue de les inciter à les réduire ; mais dans le même temps cette institution affirme qu’il est déjà trop tard. Quel est le sens de cette contradiction ? Elle pourrait simplement signifier qu’en matière de rejets de gaz à effet de serre, les pays de l’OCDE feront des efforts raisonnables… On ne saurait être plus discrètement cynique. Et pendant ce temps, des institutions comme l’Agence européenne pour l’environnement, continuent à accumuler les affirmations gratuites, formulées au futur : les changements climatiques « (…) affecteront considérablement nos sociétés et nos environnements dans les décennies et les siècles à venir »… – et d’exiger la ratification du protocole de Kyoto (1997) sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont nombre d’observateurs considèrent désormais qu’il ne sera jamais mis en application.
Qu’il soit néanmoins bien clair que ce qui précède n’accuse pas les scientifiques du GIEC : la maîtrise énergétique du monde par les pays les plus riches n’est pas de la responsabilité du GIEC, dont les rapports peuvent d’ailleurs ne pas toujours plaire aux États-Unis, et aux pays du G7 ou de l’OCDE qui sont parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre et qui, objectivement, entendent bien le rester. On sait à quel point les importations d’hydrocarbures et de matières premières par la Chine ont fait flamber les prix au cours du premier semestre de l’année 2004 et inquiètent les pays les plus riches. De manière comparable, tout observateur attentif de la politique internationale sait que le développement des pays les moins avancés, dans l’intérêt immédiat des populations locales, n’est pas pour les pays du G7 une priorité authentique.
Mais en attirant l’attention du public sur les conséquences dramatiques d’un réchauffement climatique scientifiquement annoncé, le GIEC intervient objectivement dans la stratégie des maîtres du monde en matière de consommation et de production énergétique dans les pays avancés, comme dans les pays émergents, comme dans les pays dits « en voie de développement ». Avec la meilleure bonne foi qui soit, les scientifiques les plus honnêtes peuvent à leur insu servir des causes qui ne sont ni pures ni neutres.
Ainsi, l’OCDE finance une Task Force dont l’objectif est d’évaluer, pays par pays, les émissions de GES, en vue de les inciter à les réduire ; mais dans le même temps cette institution affirme qu’il est déjà trop tard. Quel est le sens de cette contradiction ? Elle pourrait simplement signifier qu’en matière de rejets de gaz à effet de serre, les pays de l’OCDE feront des efforts raisonnables… On ne saurait être plus discrètement cynique. Et pendant ce temps, des institutions comme l’Agence européenne pour l’environnement, continuent à accumuler les affirmations gratuites, formulées au futur : les changements climatiques « (…) affecteront considérablement nos sociétés et nos environnements dans les décennies et les siècles à venir »… – et d’exiger la ratification du protocole de Kyoto (1997) sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont nombre d’observateurs considèrent désormais qu’il ne sera jamais mis en application.
Qu’il soit néanmoins bien clair que ce qui précède n’accuse pas les scientifiques du GIEC : la maîtrise énergétique du monde par les pays les plus riches n’est pas de la responsabilité du GIEC, dont les rapports peuvent d’ailleurs ne pas toujours plaire aux États-Unis, et aux pays du G7 ou de l’OCDE qui sont parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre et qui, objectivement, entendent bien le rester. On sait à quel point les importations d’hydrocarbures et de matières premières par la Chine ont fait flamber les prix au cours du premier semestre de l’année 2004 et inquiètent les pays les plus riches. De manière comparable, tout observateur attentif de la politique internationale sait que le développement des pays les moins avancés, dans l’intérêt immédiat des populations locales, n’est pas pour les pays du G7 une priorité authentique.
Mais en attirant l’attention du public sur les conséquences dramatiques d’un réchauffement climatique scientifiquement annoncé, le GIEC intervient objectivement dans la stratégie des maîtres du monde en matière de consommation et de production énergétique dans les pays avancés, comme dans les pays émergents, comme dans les pays dits « en voie de développement ». Avec la meilleure bonne foi qui soit, les scientifiques les plus honnêtes peuvent à leur insu servir des causes qui ne sont ni pures ni neutres.
Vidéo : L’effet de serre additionnel : catastrophisme
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : L’effet de serre additionnel : catastrophisme
